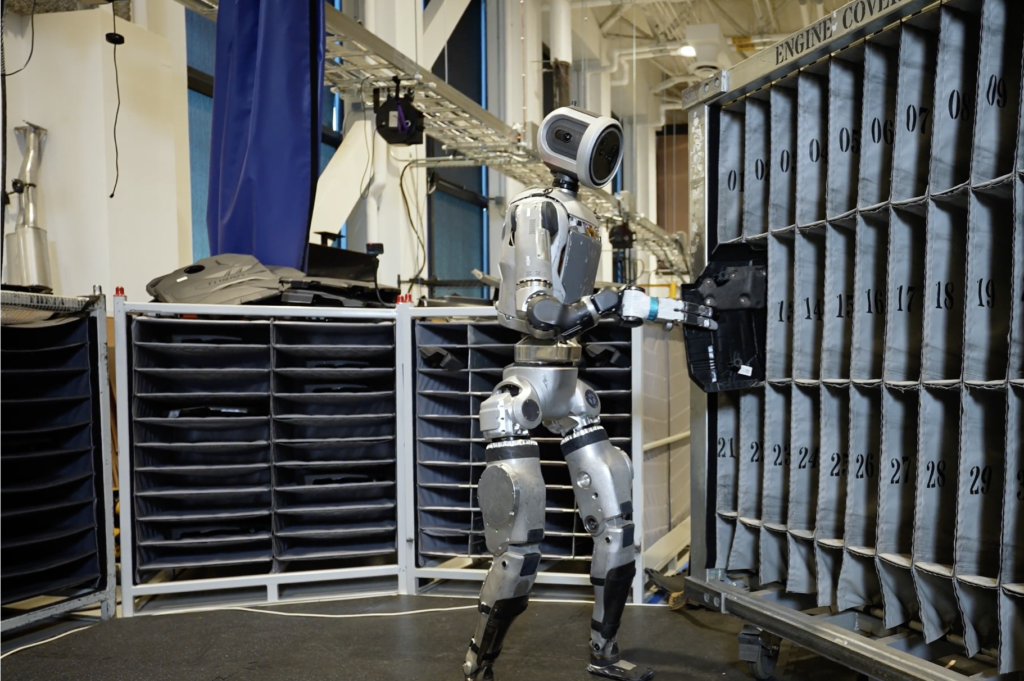Népal, Madagascar, Maroc : partout ces dernières semaines, des mouvements contestataires se sont formés dans les rues. Avec pour but de protester contre les régimes en place. L’une des raisons de ces mouvements est également le ras-le-bol généralisé d’une politique qui dessert plus le peuple qu’autre chose. Des crises qui en rappellent d’autres bien plus violentes connues ces 20 dernières années.
Le souvenir du printemps arabe
Kadhafi, Ben Ali, Moubarak : pour la jeune génération, ces noms ne veulent sûrement rien dire. Ces noms sonnent en effet comme une autre époque. Pourtant la chute de ces despotes suite à des révolutions populaires, a changé le monde. En poste pour la plupart depuis les années 60-70, ces anciens présidents ont opprimé leurs peuples et la cause de leurs chutes est commune. Chômage élevé, notamment chez les jeunes diplômés, inégalités économiques criantes, corruption endémique, clientélisme, népotisme. Tous ces éléments ont créé la “pichenette” pour tout faire exploser.
Le déclencheur de 2011 s’appelle Mohamed Bouazizi. 26 ans, vendeur au marché pour subvenir aux besoins de sa famille. Un jour, une policière lui confisque sa charrette et ses marchandises sous prétexte qu’il n’a pas d’autorisation de vente. Humilié et refusé par les autorités locales à qui il veut porter plainte, il s’immole par le feu devant le siège du gouvernorat.
Ce micro-événement va déclencher un déferlement planétaire. Rapidement, l’histoire de Bouazizi fait le tour du monde et surtout le tour de l’Afrique du Nord. Par la suite, ce sont des millions de Maghrébins qui vont sortir dans les rues pour réclamer leurs droits.
Faillite collective des dirigeants
Car si aujourd’hui, des millions de jeunes décident de sortir hurler leur colère. La raison est toute trouvée : la faillite des politiques publiques. Dans une génération ultra connectée avec un accès à l’information quasi-illimitée, difficile de passer inaperçu. Alors quand une loi ou un décret sort, les réactions sont immédiates. En 2019, quand le mouvement des Gilets Jaunes sort dans la rue, cette même “Gen Z” (née entre 1997 et 2012) prend la relève de la précédente génération et se lève pour faire entendre leur voix. Même si la génération concernée était plus celle de leurs parents.
Ce que cette génération réalise également aujourd’hui, si le système de reproduction sociale et de méritocratie qui leur est, pour la plupart, défavorable. Étant bassiné avec le fait de faire un bon parcours scolaire (Bac +5) pour avoir une bonne situation et bien vivre, beaucoup déchantent. Ils se rendent compte que le système est biaisé, pour certains, dès le lycée.
Une génération ultra connectée
L’information, aujourd’hui, est faite de telle sorte à ce que l’on soit au courant toutes les 10 secondes. Le système de réactualisation du “feed” (fil d’actualité) sur Instagram, X ou encore Facebook permet à tout un chacun d’être informé à la seconde. Cela peut créer une sorte de nihilisme ou une imperméabilité à la violence que l’on peut retrouver aujourd’hui chez les plus de 13 ans.
Cela crée alors un écosystème où il est difficile de cacher quoi que ce soit. La crise actuelle au Népal, qui s’est soldée par la démission totale du gouvernement en place, démarre d’abord du style de vie affichée par les enfants de gouvernants ( hôtel de luxe, train de vie ahurissant, écoles très chères) alors que le népalais moyen vit avec moins de 2€ par jour.
Avec les réseaux sociaux, chacun voit ce qui se passe dans le pays de l’autre, cela crée une sorte d’émulation de la révolution collective.
Gérer « l’après«
Le problème dans ces révolutions populaires, c’est toujours la transition. Après le printemps arabe de 2011, seule la Tunisie a connu une transition vers un système démocratique plus stable. L’Egypte est revenue à un régime militaire tandis que la Libye, le Yémen et la Syrie ont sombré dans le chaos, les guerres civiles.
L’après-Ceausescu en Roumanie a vite tourné au cauchemar. Le Front de salut national, mouvement ayant renversé le dictateur et sa femme, a tué d’innombrables civils, pensant être de loyalistes au dictateur. Le soulèvement sera vite tronqué et laissera la place à une nouvelle dictature.
Le problème généralement, c’est que ces révolutions sont spontanées, organiques et très peu organisées et disciplinées. Donc quand la suite est demandée par le peuple, les chefs révolutionnaires reprennent les mêmes codes de leurs prédécesseurs.