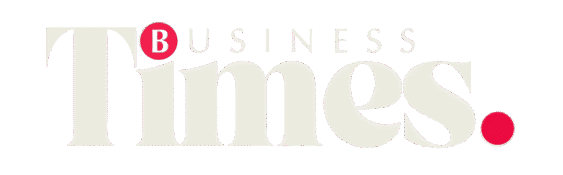Selon une enquête récente de l’Institut Montaigne, la Mutualité française et l’Institut Terram, 25 % des 15-29 ans se déclarent atteints de dépression, selon leur propre estimation. Comparé à 10 % e 2019 pour les 15-24 ans, c’est donc une multiplication par plus de deux en seulement six ans. Ce chiffre inquiétant est confirmé par Santé publique France qui déclare que 20,8 % des 18-24 ans souffraient déjà de dépression en 2021 déjà, soit une hausse d’environ 80 % par rapport à 2017. Enfin, entre 2027 et 2021, les jeunes de 18-24 ans sont aussi particulièrement touchés par la hausse des états dépressifs en passant de 11,7 % en 2017 à 20,8 % en 2021.
Pourquoi cette explosion de la dépression chez les jeunes ?
La pandémie de COVID-19 reste le déclencheur brutal. Les confinements successifs ont plongé les jeunes dans l’isolement, supprimé les repères sociaux et accentué l’incertitude sur l’avenir. En quelques mois seulement, les taux de dépression ont doublé chez les 15-24 ans. Pour beaucoup, cette parenthèse douloureuse a marqué un basculement durable.
Mais la crise sanitaire n’est que l’arbre qui cache une forêt de facteurs. L’entrée dans la vie adulte s’accompagne aussi d’une précarité sociale et économique qui fragilise : jobs instables, difficulté à se loger, sentiment que l’ascenseur social est en panne. Les réseaux sociaux ajoutent une pression supplémentaire. S’ils permettent de rester connectés, ils sont aussi le théâtre permanent de la comparaison et du jugement, nourrissant anxiété et sentiment de dévalorisation. Enfin, sur un plan biologique et psychologique, l’adolescence et le jeune âge adulte sont des périodes naturellement plus vulnérables aux premiers épisodes dépressifs. Le résultat, c’est une génération exposée à une combinaison de risques inédite.
Une bombe à retardement pour la société
Les conséquences de cette dégradation sont multiples et préoccupantes. Le risque suicidaire, d’abord, est en forte hausse : près d’un tiers des jeunes adultes déclarent avoir déjà eu des pensées suicidaires. Dans les hôpitaux, les services de psychiatrie et d’urgences voient affluer des jeunes en détresse psychologique, débordant des capacités déjà limitées.
Sur le plan scolaire et universitaire, la dépression provoque isolement, démotivation et décrochage. Les parcours professionnels s’en trouvent impactés, menaçant l’insertion de toute une génération. À terme, c’est la cohésion sociale et la vitalité économique qui sont en jeu : une jeunesse qui perd confiance en son avenir, c’est une société entière qui se fragilise.
Des politiques encore trop timides
Face à ces signaux rouges, les pouvoirs publics se sont emparés du sujet, mais timidement. Le plan décennal Psychiatrie et santé mentale, les campagnes de sensibilisation ou encore les formations en secourisme psychologique vont dans le bon sens. Mais la réalité du terrain est cruelle : manque de psychiatres et de psychologues, délais interminables pour obtenir un rendez-vous, coût élevé des consultations non remboursées. Les jeunes, souvent précaires, sont les premiers à renoncer aux soins.
Après la COVID-19, le chef d’État avait promis un « plan Marshall de la santé mentale ». Quatre ans plus tard, les professionnels constatent surtout des mesures dispersées, loin de répondre à l’urgence. Résultat : un décalage criant entre les discours politiques et la réalité vécue par les jeunes. Ce fossé nourrit un sentiment d’abandon qui aggrave encore leur malaise.
Une urgence à ne plus ignorer
La dépression des jeunes n’est pas une mode passagère ni une exagération statistique. C’est une réalité profonde, aux causes multiples et aux conséquences durables. Une société qui laisse un quart de sa jeunesse sombrer ne peut espérer un avenir apaisé.
La réponse doit être à la hauteur : développer massivement l’accès aux soins psychologiques, renforcer la prévention à l’école et sur les réseaux sociaux, et intégrer la santé mentale comme une priorité nationale au même titre que l’éducation ou la sécurité. Retarder l’action, c’est accepter que le malaise s’installe. Agir, au contraire, c’est donner à la jeunesse les moyens de se relever, et offrir à la société un futur plus solide.